Lors de son premier mandat, Donald Trump n’avait pas caché sa méfiance à l’encontre de la politique économique chinoise. Le déficit commercial américain envers la Chine mettait notamment à mal son projet de « rendre sa grandeur à l’Amérique ». Il jugeait déloyales les pratiques commerciales de la Chine telles les subventions accordées par Pékin à ses entreprises, le transfert forcé de technologies américaines et même le « vol » de propriété intellectuelle. Il demandait des changements structurels importants susceptibles de bouleverser le modèle économique chinois. Pour parvenir à cet objectif, Donald Trump recourt à la manière forte lors de son investiture du 20 janvier dernier comme 47e président des USA : augmentation des taxes à l’importation des produits chinois et renforcement des droits de douane pour protéger les industries américaines.
Comprendre la position de Trump
Les clameurs qu’on entend souvent lorsque des Etats planifient des mesures protectionnistes contre un commerce ruinant des domaines économiques entiers, voire des économies nationales entières, ne sont ni honnêtes, ni justes. Si l’on a pu observer la diminution progressive des droits de douane à l’importation ces vingt-cinq dernières années, en revanche des mesures non tarifaires (MNT) n’ont cessé de croître. Autrement dit, une guerre commerciale « sans bruit de canons » se déroule sous nos yeux depuis des décennies. Les MNT sont beaucoup plus restrictives que les droits de douane et ont un effet négatif sur la diversification des marchés d’exportation. Bien plus, dans les échanges commerciaux, ce sont les Etats respectueux des règles du jeu, ayant fortement ouvert leur marché qui sont le plus souvent pénalisés, au profit d’un nombre limité de pays peu soucieux du respect des engagements internationaux. Lors du déclenchement du conflit commercial USA/Chine au premier mandat de Trump, l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), plus portée à menacer de sanctions les petits pays preneurs de prix, était restée aphone. Cette position ambiguë interroge, d’autant plus quelques années avant, le Cameroun a été contraint de signer un accord commercial insoutenable sous le fallacieux prétexte qu’il était « OMC-compatible ». La posture de Donald Trump peut aussi se comprendre en faisant appel à la théorie économique. Adam Smith a introduit la théorie de l’avantage absolu pour décrire des situations où un pays a intérêt à exporter les biens qu’il produit à un coût inférieur mais par contre, peut s’engager à importer les biens qu’il produit à un coût supérieur. Ce raisonnement ne marche plus au cas où un pays peut produire à un moindre coût et sans limitation de volume tous les biens dont a besoin un autre pays. Dans cette situation, l’ouverture conduit à l’impossibilité de l’échange. David Ricardo a introduit la théorie d’avantage comparatif, qui explique comment les pays peuvent malgré tout échanger dans cette situation. Ainsi, si un pays se spécialise dans la production pour laquelle il dispose de la productivité la plus forte ou la moins faible, comparativement à ses partenaires, il accroîtra sa richesse nationale. C’est le credo officiel de l’OMC. Ce que l’on ne souligne pas assez, c’est que la théorie ricardienne montre que le libre-échange est préférable à l’autarcie, et non qu’il est supérieur à toute politique commerciale intermédiaire. Si des études empiriques ont certes établi que l’ouverture au commerce s’accompagne d’une efficacité plus grande et d’une croissance économique forte, en revanche, la théorie ricardienne montre que l’ouverture commerciale modifie la répartition de la richesse au détriment de certains agents économiques (pays pauvres ou ceux ayant un appareil industriel fragile). En l’absence des réglementations appropriées, l’ouverture n’entraîne pas un accroissement des échanges. Par ailleurs, la non maîtrise des instruments juridiques pour promouvoir le commerce et faciliter le transport, a pour conséquence un système de facilitation inefficace et un coût élevé en matière d’exportation et d’importation. Il faut également prendre conscience que l’ouverture est porteuse de risques (une désindustrialisation prématurée pourrait voir le jour si la libéralisation du commerce a lieu sans prendre en compte la compétitivité des entreprises nationales). L’ouverture peut exacerber les problèmes fiscaux, augmenter les déficits budgétaires et surtout commerciaux, accélérer l’inflation et mettre politiquement les gouvernements en difficulté. Nos pays, qui souffrent de graves contraintes de capacité techniques et administratives pour concevoir, négocier et mettre en œuvre la libéralisation de leur commerce, ne peuvent donc tirer tous les « bienfaits » du libre-échange.
Les pièges grossiers du discours dominant
Sur un plan général, le néolibéralisme, guidé par des considérations idéologiques très souvent erronées, a imposé partout ses évidences. Les « terroristes de la pensée » ignorent, systématiquement, l’analyse pénétrante et réaliste d’Adam Smith sur les contradictions inhérentes à l’économie de marché. Smith nous prévenait qu’une société dépourvue de toute distribution importante des fruits du progrès économique vers la masse de la population est moralement...






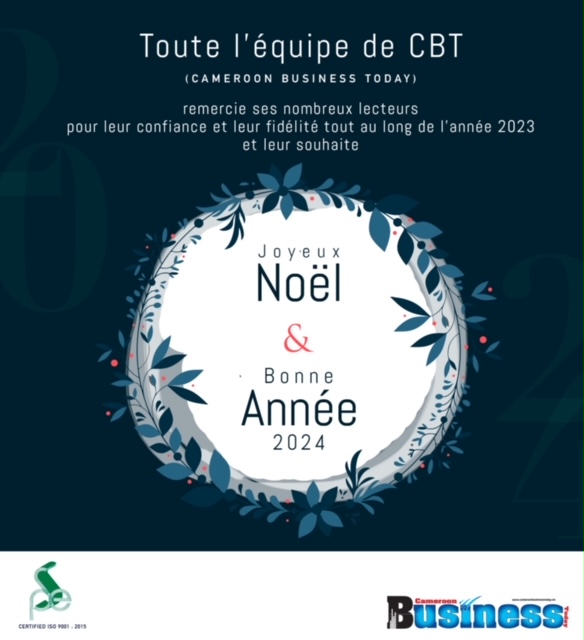









Commentaires